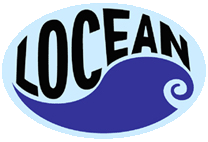OISO
Océan Indien Service d'Observations
L'objectif principal du programme OISO est de contribuer au réseau international
d'obsevation du CO2 ocanique. La synthèse de ces données permet notamment de ré-évaluer
tous les ans le bilan global de
carbone et valider les simulations numériques pour réduire l'incertitude des
prédictions climatiques.
Au niveau régional, les observations OISO pemettent de suivre et mieux comprendre
l’évolution du flux air-mer de CO2 dans cette région (variabilité interannuelle et décennale,
tendances à long-terme), l'accumulation de CO2 anthropique dans la colonne d'eau (eaux modales,
eaux profondes, eaux antarctiques de fond) et l'acidification des eaux (en surface et dans la
colonne d'eau). Des mesures complémentaires ont également été écollectées pour mieux comprendre
la variabilité de la pompe biologique de carbone en lien avec la dynamique des communautés
phytoplanctoniques.
En collaboration avec le programme THEMISTO (resp. C. Cotté, LOCEAN), les observations OISO permettent
aussi de mieux comprendre l’impact de l’environnement sur les échelons supérieurs de la chaîne trophique
(hydrologie, hydrodynamisme, structure des communautés phytoplanctoniques) et évaluer leur réponse aux
perturbations anthropiques. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du site atelier Indien Sud dont
un des objectifs est de fournir les bases scientifiques pour la gestion de la Réserve Nationale Naturelle
des Terres Australes Françaises (terres et mers inscrites au patrimoine de l’UNESCO depuis 2019).
Contexte scientifique
L'observation et la compréhension des variations saisonnières,
inter-annuelles et décennales du CO2 océanique sont primordiales
pour estimer les bilans de carbone à l'échelle planétaire et
paramétrer puis valider les modèles climatiques prédictifs. Jusque
dans les années 80, très peu de mesures répétitives de CO2 total
et de la pression partielle pCO2 existaient pour le compartiment
océan. Dans les années 90, les expériences WOCE et JGOFS ont
permis d'accroître considérablement ces observations. Les
résultats de ces expériences associées à d'autres mesures sur le
terrain ont, en particulier, permis d'établir une première
climatologie mondiale des flux air-mer de CO2 (Takahashi et al.,
2002) permettant notamment de contraindre les méthodes
d'inversions atmosphériques (e.g. Bousquet et al., 2000). Elles
ont aussi montré que la variabilité des flux air-mer de CO2
pouvait être importante notamment dans le secteur du Pacifique
Equatorial en liaison avec les évènements ENSO (e.g. Feely et al.,
2002), ainsi que dans l'Océan Austral (e.g. Metzl et al., 1999 ;
Jabaud-Jan et al., 2004).
Elles ont enfin permis de dresser pour la première fois un
inventaire de carbone anthropique dans l'océan mondial (Sabine et
al., 2004) avec, il faut le noter, de grandes incertitudes dans
l'Océan Austral (Lo Monaco et al., 2005a,b).
Fort de cet élan initié durant les années 90, la communauté
internationale a décidé de renforcer ce type d'observations, tant
sur les séries de surface que sur la colonne d'eau. Ces séries
d'observations révèlent des informations déterminantes sur l'état
du système biogéochimique dans l'océan, sa variabilité et son
évolution, permettant d'aborder des questions centrales pour une
meilleure connaissance du couple climat/carbone dans un contexte
de changement climatique: évolution du puits océanique de C02,
sequestration du CO2 anthropique en profondeur, impacts
anthropiques et rétroactions (acidification, réchauffement,
stratification, changements d'écosystèmes).
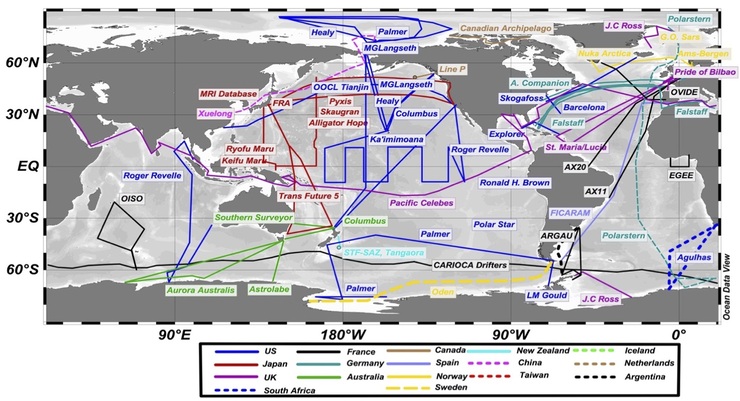
Objectifs et stratégie d'observation
Le Service d'Observation OISO met en place un réseau couplé de
mesures océaniques et atmosphériques à long terme afin de mieux
identifier et quantifier les variations des sources et puits de
CO2 océaniques, de comprendre comment les échanges air-mer de CO2
varient d'une saison à l'autre ou d'une année à l'autre, d'estimer
l'évolution de ces échanges en réponse à des changements
climatiques et de quantifier l'accumulation de carbone anthropique
dans l'océan et son évolution. Outre l'étude détaillée du cycle du
CO2 océanique dans la zone sud-ouest indienne et australe, les
données recueillies lors des campagnes OISO sont utilisables pour
contraindre et valider les modèles océaniques, les modèles
couplés, et les modèles atmosphériques inverses et sont
assimilables dans les approches prédictives.
La reconnaissance des processus responsables des variations du
cycle du CO2 océanique nécessite un suivi pluriannuel et
pluridécennal de la même région. Le programme OISO prévoit une à deux
campagnes par an (a minima en été austral,comprenant des mesures de
surface en continu et des prélèvements en stations
(propriétés mesurées).
Pour des raisons logistiques le choix d'un suivi à long terme a
été fixé sur les zones océaniques couvertes par les trajets des
rotations du Marion-Dufresne (TAAF) dans l'Océan Indien Sud.
En complément des trajets logistiques inter-îles (La Réunion -
Crozet - Kerguelen - Amsterdam), les observations OISO sont
étendues vers le Sud pour le suivi saisonnier et interannuel en
zone australe et pour revisiter les sites GEOSECS (1978), INDIGO
(1985-1987)et KERFIX (1990-1995). Une attention particulière est
portée sur la zone australe, très peu documentée et qui est loin
d'être correctement représentée par les modèles globaux du cycle
de carbone océanique, y compris les aspects dynamiques pour
lesquels OISO fournit des informations intéressantes, par exemple
sur la variabilité de la couche de mélange océanique.
Le programme OISO est soutenu par
l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU)
la Flotte Océanographique Française (FOF)
les Infrastructures de Recherche ICOS et OHIS
l'OSU Ecce Terra (Sorbonne Université)
l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL)
le Laboratoire d'Océanographie et du Climat (LOCEAN)